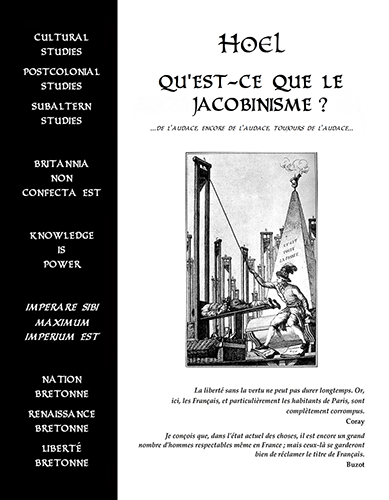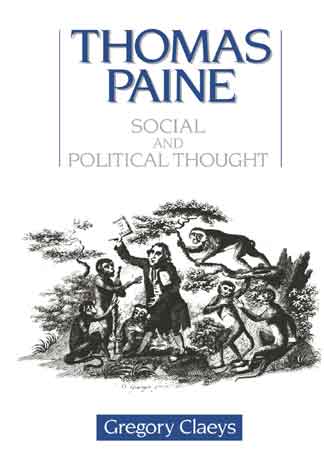Toute personne qui consulte Wikipedia et qui s’amuse à comparer des versions d’articles dans diverses langues se rend vraisemblablement compte à un moment ou un autre qu’il existe dans cette encyclopédie certaines lacunes qui ne peuvent pas être entièrement le résultat du hasard.
⟡
Voici un premier exemple : l’article « Ethnocide ». L’introduction dans sa version francophone est la suivante :
« L’ethnocide est la destruction de l’identité culturelle d’un groupe, sans détruire physiquement ce groupe (génocide) et sans forcément user de violence physique contre lui (persécution, déportation, enlèvement des enfants). Un ethnocide peut être la conséquence d’un changement économique ou social progressif ou d’une politique d’État, en cela ce terme peut concerner un grand nombre d’exemples ; on a qualifié d’ethnocide l’acculturation des Amérindiens ou des aborigènes d’Australie, les modifications profondes de la culture traditionnelle du Tibet en Chine, la russification des peuples premiers de Sibérie, l’assimilation des Aïnous du Japon et des Kouriles, la lutte de l’état indonésien contre l’animisme, l’arabisation des Berbères en Afrique du Nord ou encore la tentative de Franco d’éradiquer les langues catalane et basque dans les années 1930 en Espagne. »
Rien sur la France ?
⟡
Voici un deuxième exemple avec l’article « Léopold de Saussure » :
« Léopold de Saussure (1866–1925) est issu d’une illustre famille de savants suisses, d’origine française (protestants de Lorraine, réfugiés en Suisse dès 1636 avant la révocation de l’édit de Nantes).
Léopold de Saussure est un sinologue et astronome, officier de la marine française, pour laquelle il navigue comme lieutenant jusqu’en 1899, ce qui lui permis d’apprendre le chinois. C’est le fils de Henri de Saussure, et c’est un descendant d’Horace-Bénédict de Saussure, mais surtout, c’est le frère du linguiste Ferdinand et de René, un des principaux promoteurs de l’espéranto. Pour sa part, c’est un pionnier reconnu de l’astrologie et de l’astronomie chinoise, qui a publié ses travaux dans la revue T’oung pao entre 1907 et 1922, mais aussi dans les Archives des sciences physiques et naturelles de Genève… »
« T’oung Pao (en chinois 通報 ; en pinyin Tōngbào) est la 1re revue internationale de sinologie fondée en 1890. »
L’article comprend des « liens » et des « références », mais — contrairement à ce qui est la règle généralement suivie sur Wikipedia — pas de partie spécifiquement consacréé à la bibliographie. Les « liens » citent deux livres : Les Origines de l’astronomie chinoise et Le Système astronomique des Chinois.
Il existe également une version en magyar (hongrois) et une autre en anglais. Dans ces deux versions apparaît un livre ignoré par la version française :
Extraits de l’article en hongrois :
« Élete, munkássága [Sa vie, son travail]
[…] Első jelentősebb publikációját Psychologie De La Colonisation Française címen 1899-ben jelentette meg. […]
Főbb művei [Principales oeuvres] Psychologie De La Colonisation Française: Dans Ses Rapports Avec Les Sociétés Indigènes. Paris: F. Alcan (1899. október 23.) Internet Archive »
Extraits de l’article en anglais :
« Léopold de Saussure (30 May 1866 – 30 July 1925) was a Swiss-born French sinologist, pioneering scholar of ancient Chinese astronomy, and officer in the French navy. After a naval career which took him to Indochina, China, and Japan, he left the service and devoted the rest of his life to scholarship. He was most famous for his studies of ancient Chinese astronomy. […]
Career […] From his early teens de Saussure set out to make a career in the navy, an undertaking which one historian called « a somewhat problematic undertaking in Switzerland. » Saussure, with his father’s permission, became a French citizen in order to enter the École Navale, and in 1885 went to sea as a cadet. In 1887, he successfully demanded admission to the Ecole des Langues orientales vivantes in Paris. […]
On his return to France, he applied his energies entirely to research. After publishing an article on Korea, he published his first major work, Psychologie De La Colonisation Française (1899). The volume offered an analysis of the assimilation of the French language among colonialized peoples. He echoed some of the linguistic concepts of his brother, Ferdinand, but subscribed, as Ferdinand did not, to the concept of a « psychological race » modeled on the concept « historical race » offered by Gustave le Bon. […]
Representative works :
—— (1899). Psychologie De La Colonisation Française: Dans Ses Rapports Avec Les Sociétés Indigènes . Paris: F. Alcan. Internet Archive »
« After publishing an article on Korea, he published his first major work, Psychologie De La Colonisation Française (1899). The volume offered an analysis of the assimilation of the French language among colonialized peoples. »
« Après avoir publié un article sur la Corée, il publia sa première oeuvre majeure, Psychologie De La Colonisation Française (1899). Le volume offrait une analyse de l’assimilation de la langue française chez les peuples colonisés. »
Le livre de Léopold de Saussure est une analyse de la politique assimilatrice des peuples colonisés entreprise par la France. Parmi les quinze chapitres se trouvent les suivants :
- La doctrine de l’assimilation
- Les effets de l’assimilation
- L’assimilation par l’éducation
- L’assimilation par les institutions
- L’assimilation par la langue
- Les congrès coloniaux de 1889 et les arguments de l’assimilation
La politique assimilatrice ne concerne donc pas que la langue, elle concerne l’éducation de manière globale et les institutions.
« Les races conquérantes les plus habiles ont compris la nécessité de ne pas heurter les croyances de leurs sujets et de respecter leurs institutions. Les Français, au contraire, essayent de transformer les sociétés indigènes avant même d’avoir assis leur conquête. Ils professent que les institutions, les croyances, les langues même, entretiennent l’hostilité des indigènes contre le nouvel état de choses, et que pour obtenir leur sympathie ou leur résignation, il n’y a qu’une méthode efficace : l’assimilation. »
« De même que les anciens conquérants espagnols voyaient dans les curieuses civilisations de l’Amérique centrale des pratiques diaboliques indignes d’être respectées et qu’il importait de vouer à une destruction immédiate, de même, dans les civilisations de l’Indo-Chine, dans ces monuments de la tradition et de la sagesse de peuples très affinés, nous ne voyons que des institutions hostiles à notre domination et que nous nous efforçons de saper pour transformer ces races à l’image de la nôtre.
La colonisation espagnole était basée sur l’assimilation par les croyances religieuses au nom d’un idéal dogmatique et absolu.
La colonisation française est basée sur l’assimilation politique et sociale au nom d’un idéal non moins dogmatique et non moins absolu. »
Léopold de Saussure – Psychologie de la Colonisation Française dans ses Rapports avec les Sociétés Indigènes (1899)
⟡
L’assimilation vise à « vouer à une destruction immédiate », à « saper » « les institutions, les croyances, les langues même » des peuples colonisés. Autrement dit il s’agit ni plus ni moins que d’ « ethnocides » : « la destruction de l’identité culturelle d[e] groupe[s] ».
Léopold de Saussure fait remonter cet « idéal … dogmatique et … absolu » à la Révolution française :
« Pénétrée de cette idée consacrée par la Révolution, qu’il existe une formule absolue pour faire le bonheur des peuples, formule indépendante des temps et des lieux, la France s’attribue la mission d’en hâter l’avènement chez ses sujets. Elle est persuadée que sa gloire et ses intérêts sont également liés à la réalisation de cet idéal et l’assimilation morale des races les plus hétérogènes sur lesquelles elle a étendu sa souveraineté lui apparaît non seulement comme le but, mais surtout comme le moyen de sa domination. »
Cet « idéal … dogmatique et … absolu » de l’assimilation se trouve développé dans un long rapport de l’abbé Grégoire : Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, et déjà dans un essai précédent : Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs.
« Sans doute on parviendra quelques jours à extirper cette espèce d’argot, ce jargon tudesco-hébraïco-rabbinique dont se servent les Juifs allemands, qui n’est intelligible que pour eux, et ne sert qu’à épaissir l’ignorance ou à masquer la fourberie. »
Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs (1789)
« Nous n’avons plus de provinces, & nous avons encore environ trente patois qui en rappellent les noms. »
« …les vraies dénominations prévaudront même parmi les ci-devant Basques & Bretons, à qui le gouvernement aura prodigué ses moyens : & sans pouvoir assigner l’époque fixe à laquelle ces idiômes auront entièrement disparu, on peut augurer qu’elle est prochaine. »
Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française (1794)
⟡
Le terme « régénération » utilisé par Grégoire est l’équivalent du terme « assimilation », lui-même synonyme du mot « ethnocide ». Grégoire ne veut pas seulement anéantir les « patois », il veut anéantir jusqu’aux noms de ceux qui les parlent et aux noms de leurs « provinces » (c’est pourquoi il utilise le mot « ci-devant » devant « Basques & Bretons »).
⟡
Dans l’article de Wikipedia sur l’abbé Grégoire, un paragraphe est intitulé : « Universaliser l’usage de la langue française et éradiquer les langues dites régionales ou minoritaires » :
« Dès le 13 août 1790, l’abbé Grégoire, membre de la Constituante, lance une importante enquête relative « aux patois et aux mœurs des gens de la campagne ». Puis, à partir de 1793, pendant la Convention, au sein du Comité d’instruction publique où il se montre très actif, il lutte pour l’éradication de ces patois. L’universalisation de la langue française par l’anéantissement, non seulement des patois, mais des langues des communautés minoritaires (yiddish, créoles) est pour lui le meilleur moyen de répandre dans la masse les connaissances utiles, de lutter contre les superstitions et de « fondre tous les citoyens dans la masse nationale », de « créer un peuple ». En ce sens, le combat de Grégoire pour la généralisation (et l’enseignement) de la langue française est dans le droit fil de sa lutte pour l’émancipation des minorités. En, 1794 l’abbé Grégoire présente à la Convention son « Rapport sur la Nécessité et les Moyens d’anéantir les Patois et d’universaliser l’Usage de la Langue française », dit Rapport Grégoire, dans lequel il écrit :
« […] on peut uniformiser le langage d’une grande nation […]. Cette entreprise qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. »
Nulle mention ici d’ethnocide, de génocide ou de génocide culturel, ni même de régénération. Au contraire, on y trouve des expressions nettement valorisantes :
« est pour lui le meilleur moyen de répandre dans la masse les connaissances utiles, de lutter contre les superstitions et de « fondre tous les citoyens dans la masse nationale », de « créer un peuple ». »
« dans le droit fil de sa lutte pour l’émancipation des minorités. »
Les formulations valorisantes sont d’abord celles de l’abbé Grégoire lui-même (« pour lui »), puis le rédacteur utilise l’expression « l’émancipation des minorités », qui n’est pas de Grégoire.
Emanciper les « minorités » en les faisant disparaître !
⟡
Voici ce qui est écrit dans la version anglaise de l’article :
« According to his own research, a vast majority of people in France spoke one of 33 dialects or patois and he argued that French had to be imposed on the population and all other dialects eradicated. According to his classification, which was not necessarily reliable, Corsican and Alsatian were described as « highly degenerate » (très-dégénérés) forms of Italian and German while Occitan was decomposed into a variety of syntactically loose local remnants of the language of troubadours with no intelligibility among them, and had to be abandoned in favour of the language of the capital. This began a process, expanded dramatically by the policies of Jules Ferry a century later, that led to increasing disuse of the regional languages of France, all of them being subsequently banned from public documents, administration and school. One effect of this was that non-French speakers often came to feel ashamed of their home languages through official exclusion, humiliation at school and rejection from the media as organized and sanctioned by French political leaders (see Vergonha). »
L’article en anglais renvoie au début à un article intitulé « Language policy in France ». Cet article existe également en français (« Politique linguistique de la France »).
⟡
A la fin de l’article, un autre renvoi mène à un article intitulé « Vergonha » :
Celui-ci existe en onze langues — Boarisch (Bavarois), Brezhoneg (Breton), Català (Catalan), Español, Euskara (Basque), Hrvatski (Croate), Lumbaart (Lombard), Occitan, Română (Roumain), Русский (Russe), Sardu (Sarde), mais pas en français.
« La vergonha (Occitan pronunciation: [berˈɣuɲɔ, veʀˈɡuɲɔ], meaning « shame ») is what Occitans call the effects of various policies of the government of France on its citizens whose native language was a so-called patois, a language spoken in France other than French, such as Occitan or one of the dialects of the langues d’oïl. Vergonha is being made to reject and feel ashamed of one’s (or one’s parents’) non-French language through official exclusion, humiliation at school and rejection from the media as organized and sanctioned by French political leaders, from Henri Grégoire onward. Vergonha, which is still a taboo topic in France where some still refuse to admit such discrimination ever existed, can be seen as the result of an attempted linguicide. »
« La vergonha (prononciation occitanne : [berˈɣuɲɔ, veʀˈɡuɲɔ], signifiant «honte») est ce que les Occitans appellent les effets de diverses politiques du gouvernement français sur ses citoyens dont la langue maternelle était un soi-disant patois, une langue parlée en France autre que le français, tels que l’occitan ou l’un des dialectes des langues d’oïl. La vergonha est faite pour rejeter et se sentir honteux d’une langue non-française, la sienne ou celle de ses parents, du fait de son exclusion officielle, de l’humiliation à l’école et de son rejet par les médias tel que l’ont organisé et sanctionné les dirigeants politiques français à partir d’Henri Grégoire. La vergonha, qui est encore un sujet tabou en France où certains refusent encore d’admettre qu’une telle discrimination ait jamais existé, peut être considérée comme le résultat d’une tentative de linguicide. »
⟡
Le mot « linguicide » de l’article en anglais renvoie à un article intitulé « Language death » :
« In linguistics, language death (also language extinction, linguistic extinction or linguicide, and rarely also glottophagy) occurs when a language loses its last native speaker. »
Il n’existe donc pas d’article « Linguicide » en anglais. Par contre, il en existe un en français :
« Le linguicide est l’élimination concertée d’une ou de plusieurs langues par des mesures politiques explicites. Les États, sans prendre de mesures administratives, disposent de plusieurs instruments d’exécution dont les plus connus sont l’armée, l’école et les médias. Le phénomène de mort des langues peut aussi coïncider avec un ethnocide, c’est-à-dire la mort d’une langue et d’une culture. »
La bibliographie comporte deux titres … en anglais :
Amir Hassanpour, « The politics of A-political Linguistics: Linguists and Linguicide », in Rights to Language: Equity, Power, and Education, Robert Phillipon ed., Routledge, 2000, 320 p., pp. 33-39 (linguicide de la langue kurde)
Djamila Saadi-Mokrane, « The Algerian Linguicide » , in Algeria in Others’ Languages, Anne-Emmanuelle Berger ed., Cornell University Press, Ithaca and London, 2002, 246 p., pp. 44-58
⟡
« The Algerian Linguicide »
Djamila Saadi-Mokrane
« SINCE COLONIZATION and the emergence of a national movement, then Algeria’s independence in 1962, conflict has dominated the cultural and linguistic features through which people display their sense of belonging to a community. Some lay claim to the colonial legacy as an asset that opens a universal dialogue; others recognize only Arabic and Islamic currents; and still others seek to preserve the Berber characteristics of the primordial, pre-Islamic Algerian self. The issue of language arose with such a violence that, in the space of half a century, the death of three different languages was predicted: of Arabic during colonization, and of Berber, and French after the independence. “Linguicide” stands as a strategy elaborated to subjugate and reshape the identity of the country and its inhabitants by separating them from their points of reference.
For the French colonizer, it was necessary to cut to the quick the Arabic and Islamic roots of a conquered land in order to crush its core values, which offered a refuge and thus a source of resistance. Algerian leaders needed to muzzle other languages to impose the hegemony of the Arabic language on the entire nation. In fact, the existence of the pre-Islamic Berber language serves as a reminder that Algeria was not a blank slate before Islamization, and that the Arabization of the country was the consequence of an Arab conquest. The persistence of the use of French supposedly reveals Algerian’s alienated affinity for the West and its secular values. This affinity is summed up in the label hizb franza, literally, “the side of France,” which is used to designate a traitor to the country. »
« “Linguicide” stands as a strategy elaborated to subjugate and reshape the identity of the country and its inhabitants by separating them from their points of reference. »
« Le “linguicide” se présente comme une stratégie élaborée pour subjuguer et remodeler l’identité du pays et de ses habitants en les séparant de leurs points de repère. »
⟡
Le troisième chapitre de l’article « Language death » est intitulé « Language revitalization », sujet qui possède un article entier.
« Language revitalization, also referred to as language revival or reversing language shift, is an attempt to halt or reverse the decline of a language or to revive an extinct one. »
« La revitalisation linguistique, aussi appelée renaissance linguistique ou inversion du changement linguistique, est une tentative pour arrêter ou inverser le déclin d’une langue ou pour en faire revivre une éteinte. »
Il existe une vingtaine d’autres langues possédant un article sur ce sujet, mais … pas le français.
Dans Google, « revitalisation linguistique » ne conduit à aucun article de Wikipedia. Les premiers liens apparaisant se rapportent à un même auteur, James Costa, et en particulier à un article intitulé « Revitalisation linguistique : Discours, mythes et idéologies. Une approche critique de mouvements de revitalisation en Provence et en Écosse »
⟡
Le mot « régénération » possède plusieurs entrées homonymes sur Wikipedia, notamment celles-ci :
- Régénération, la faculté de reconstitution des tissus vivant.
- Régénération, la faculté d’un écosystème à se reconstituer.
- Régénération, une renaissance spirituelle : « Born again » (christianisme)
« Born again (christianisme) » : « Le terme nouvelle naissance ou born again (littéralement né de nouveau en anglais, traduit parfois par régénéré) est une expression chrétienne. Il désigne un individu qui affirme avoir vécu une régénération spirituelle après s’être réconcilié avec Dieu, et qui après cette renaissance de l’âme est appelé un enfant de Dieu. Ce point est un élément fondamental du christianisme évangélique. »
Le sens du mot tel qu’il apparaît chez l’abbé Grégoire (Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs), et plus généralement lors de la Révolution française, est absent.
⟡
On trouve une analyse du concept de « régénération » chez Grégoire dans le livre d’Alyssa Goldstein Sepinwall, The Abbé Grégoire and the French Revolution. The Making of Modern Universalism, et un compte rendu de ce livre sur le site Annales historiques de la Révolution française.
« Il reste donc jusqu’au bout attaché à un rêve de République chrétienne, dans laquelle il voit la clef de la « régénération ». Alyssa Sepinwall souligne tout à la fois la constance de cet engagement, et les nombreuses apories qui l’émaillent.
Néanmoins, sur le sens de cette « régénération », l’analyse demande éclaircissements et approfondissements. Selon l’auteur, l’utilisation de cette notion est la clef de compréhension de la façon dont Grégoire nouait la défense de certains groupes opprimés (sont particulièrement pris en compte les noirs, les juifs et les femmes) et la libération universelle, l’intégration dans la famille universelle. D’une part, cette intégration était toujours inséparable chez Grégoire de la pastorale, d’une perspective ultime de conversion à un christianisme épuré de la corruption et de l’intolérance. Au fil du temps, cette perspective est de plus en plus teintée d’apologétique ; le christianisme est l’unique message de libération universelle. En outre, l’intégration se fait toujours par le renoncement à des pans entiers de l’identité culturelle des groupes concernés ; il est particulièrement dur pour la tradition rabbinique qui enferme les juifs dans un ritualisme obscurantiste. Mais c’est également vrai pour les ancien esclaves, pour lesquels il s’agit de renoncer aux liens culturels qui les attachent encore à l’Afrique, voire de renoncer à leur être propre, et c’est tout le sens de la promotion des mariages inter-raciaux, qui doivent donner naissance à un nouveau peuple. L’auteur pense que Grégoire reste ainsi implicitement attaché à une hiérarchie des valeurs, qui préserve la position dominante des européens ; c’est en ce sens qu’il entend qu’une colonisation renouvelée pourrait établir des rapports nouveaux avec l’Afrique, mais où l’apport civilisationnel se ferait à sens unique. »
« l’intégration se fait toujours par le renoncement à des pans entiers de l’identité culturelle des groupes concernés » ;
« il s’agit de renoncer aux liens culturels qui les attachent encore à l’Afrique, voire de renoncer à leur être propre » ;
« des rapports nouveaux avec l’Afrique, mais où l’apport civilisationnel se ferait à sens unique »
L’auteur du compte rendu, B. Gainot, ne mentionne ici aucun des termes vus auparavant : « ethnocide », « génocide », « génocide culturel ». Mais les formulations utilisées (« renoncement à des pans entiers de l’identité culturelle », etc.) ne désignent pas autre chose.
Il se rattrape cependant partiellement dans la conclusion, sur le mode de l’incertitude interrogative :
« L’étude se termine par un épilogue, très intéressant, qui retrace la postérité de la figure de Grégoire, par-delà l’anecdote des funérailles si controversées. Ce n’est pas tant la haine tenace que vouèrent au républicain évangéliste et démocrate les milieux monarchistes et l’Église établie, jusqu’à la panthéonisation récente et controversée, que nous retiendrons pour terminer que les vigoureuses contestations actuelles de son universalisme : un antisémite avoué ? Un précurseur des aventures coloniales du XIXe siècle, vigoureusement nourri de la conviction que la race blanche a une mission vis-à-vis des races inférieures ? Un misogyne impénitent et hypocrite ? Et même l’initiateur d’un véritable « génocide culturel » des cultures minoritaires de l’hexagone…[…] Grégoire ne fait toujours pas consensus, et c’est une bonne chose. »
En réalité, pour Alyssa Goldstein Sepinwall, il ne fait aucun doute que l’abbé Grégoire ne soit le promoteur convaincu de « génocides culturels », mais elle utilise une autre expression : « cultural homogenization » (« homogénéisation culturelle »), expression qui n’est ici — comme elle peut l’être ailleurs — qu’une euphémisation du mot « génocide » ou de « génocide culturel ». Grégoire parle, lui, de « les fondre dans la masse nationale ».
« Euphémisme » : « Figure de pensée par laquelle on adoucit ou atténue une idée dont l’expression directe aurait quelque chose de brutal, de déplaisant. »
« “IT IS THEIR FAULT” : REGENERATION AND CULTURAL HOMOGENIZATION »
« We would misunderstand Grégoire’s idea of regeneration, however, if we thought it only meant crusading for kindness toward previously excluded groups and giving them citizenship. His frustrations—and silence—with regard to Jews are revealing. Despite his early interest in the Jewish issue, he turned his attentions elsewhere after 1789; when Jews ultimately received citizenship in 1790 (Sephardim only) and 1791 (all other Jews in France), other revolutionaries were more involved than he. […]
Indeed, new evidence gives a candid view of Grégoire’s frustrations and hesitations with regard to the Jews. In July 1791, seventeen months after the Sephardim had been deemed citizens, Grégoire explained to a Swiss friend why the Ashkenazim had not yet succeeded. Far from blaming the Jews’ opponents, he wrote: “The Portuguese and Avignonese Jews enjoy the rights of citizens, those of Alsace and Lorraine not yet—and it is their fault. They would like to keep their communities and a torrent of customs that conflict with our current government [emphasis added].” He noted that he wished them well, but that it was necessary to “dissolve them into the national mass” [« les fondre dans la masse nationale »] instead of allowing them to remain a culturally definable group. To him, the Ashkenazim’s notion of citizenship—that they could be patriotic Frenchmen while maintaining distinct Jewish practices—was absurd.
Grégoire’s comments remind us that his vision of regeneration entailed not only the immediate granting of citizenship to oppressed groups and thus their formal inclusion in the nation, but also special measures to change them. Just as Grégoire had made clear before the Revolution that the Jews needed to change physically, morally, and politically to become fully French, Grégoire now applied similar ideas to non-whites and country dwellers. The nation required a unitary character. […]
For Grégoire, difference thus appeared as a problem that needed to be solved through homogenization. The abbé was a great believer in the universal language of the Declaration; unlike many of his colleagues, he advocated immediate political rights for nearly all men. At the same time, he saw rights as only a first step. The nation needed a unified character, and groups who were different would need to alter their customs and values. The new ideal was not an entirely pre-existing one, since all of France needed to be regenerated. Some groups, however, had farther to go to get there. Country dwellers who spoke patois would need to speak only French; Jews would eventually need to convert; people of color would have to intermarry and adopt regenerated French values. Fully regenerated citizens would be French-speaking, Christian, enlightened, and light-skinned. »
« For Grégoire, difference thus appeared as a problem that needed to be solved through homogenization. […] Fully regenerated citizens would be French-speaking, Christian, enlightened, and light-skinned. »
« Pour Grégoire, la différence est donc apparue comme un problème qui devait être résolu au moyen de l’homogénéisation. […] Des citoyens complètement régénérés seraient de langue française, chrétiens, éclairés et de peau claire. »
Alyssa Goldstein Sepinwall – The Abbé Grégoire and the French Revolution. The Making of Modern Universalism
⟡
La notion d’ « homogénéisation culturelle » ne possède pas d’entrée en français dans Wikipedia, mais « Cultural homogenization » existe bien en anglais, avec cependant un sens qui s’écarte de celui que lui donne Alyssa Goldstein Sepinwall puisqu’il y désigne un processus contemporain, un des aspects de la « globalisation culturelle », et qui revient pour une grande part à une américanisation.
« The process of cultural homogenization in the context of the domination of the Western (American), capitalist culture is also known as McDonaldization, coca-colonization, Americanization or Westernization and criticized as a form of cultural imperialism and neo-colonialism. »
Cependant, pour Justin Jennings, auteur de Globalizations and the Ancient World, cité dans l’article, l’homogénéisation ne se fait pas à sens unique :
« Homogenization, therefore, is not so much about the spread of a single way of life as it is about how people come into contact with widely shared ideas and products and make them their own. »
L’ « homogénéisation culturelle » n’est donc pas ici un processus délibéré de destruction de langues, de cultures, d’institutions, comme c’est le cas dans un procesus génocidaire où tout doit disparaître, jusqu’aux noms eux-mêmes.
⟡
Les « lacunes volontaires » sur Wikipedia sont rendues particulièrement visibles du fait qu’il existe des versions en différentes langues qu’il est facile de comparer. Pour être moins visibles, elles ne sont pas moins présentes dans l’ensemble de la production intellectuelle, et on retrouverait les mêmes tendances à l’occultation sur les mêmes sujets dans, par exemple, l’Encyclopedia Universalis.